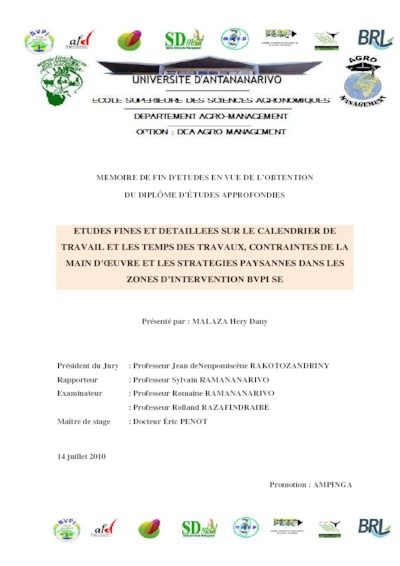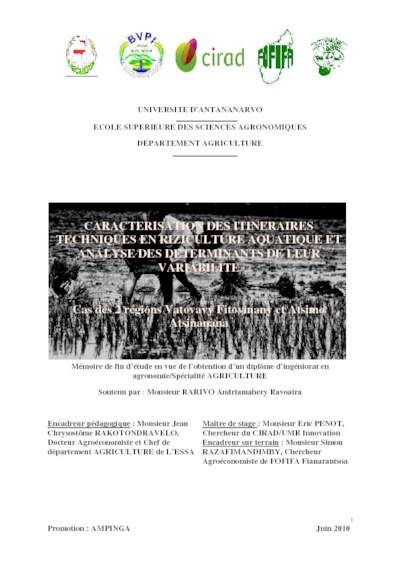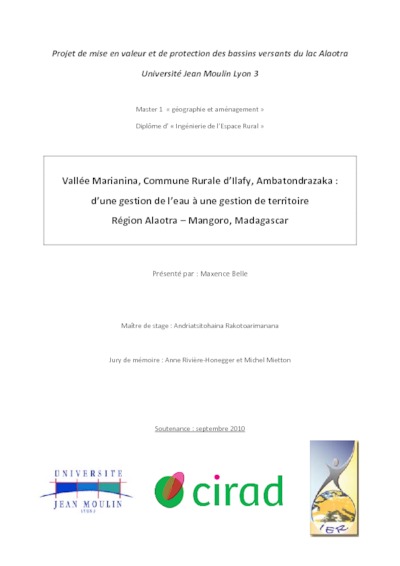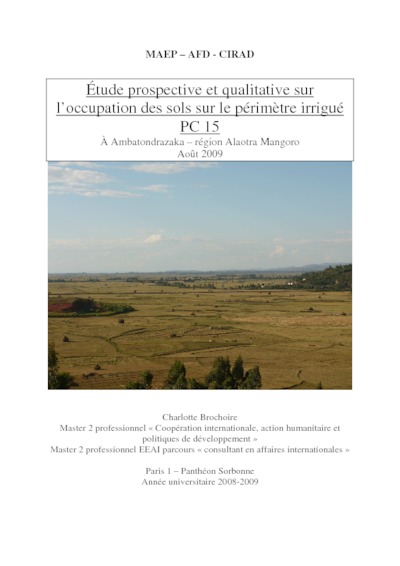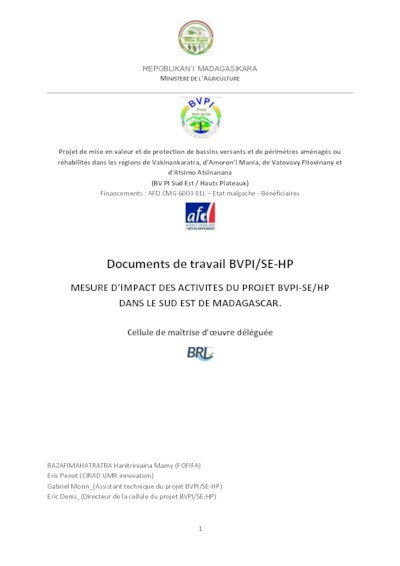Les zones Sud-Est de Madagascar sont parmi les régions bénéficiaires du projet Bassin Versant Périmètre Irriguée. Ces zones des Sud-Est ont une potentialité économique importante. Mais aussi ces zones ont ses faiblesses qui freinent le développement. L’objectif de cette étude est d’analyser les stratégies des paysans Sud-Est par rapport à l’utilisation et contrainte de main-d’œuvre et par rapport aux temps et calendrier de travail. Outre la collecte de données secondaires, des enquêtes auprès des différents types des paysans ont été réalisées. Des focus-groupes ont été faits pour chaque village des Ferme de référence. Cette étude par l’utilisation de la méthode de nuées dynamiques et d’analyse factorielle discriminante (AFD) a permis d’obtenir 3 classes des paysans et en ajoutant des autres variables les 3 classes donnent 13 sous-classes. Les contraintes de la Main-d’œuvre des zones de Sud-Est se manifestent de façon multiple. Puis les temps Off- Farm et le temps sur l’Exploitation Agricole sont complémentaires. L’affectation de la Main-d’œuvre se fait de manière raisonnable chez les paysans. La résolution des contraintes des paysans est la meilleure décision qui amène à la réussite
ETUDES FINES ET DETAILLEES SUR LE CALENDRIER DE TRAVAIL ET LES TEMPS DES TRAVAUX, CONTRAINTES DE LA MAIN D’ŒUVRE ET LES STRATEGIES PAYSANNES DANS LES ZONES D’INTERVENTION BVPI SE
CARACTERISATION DES ITINERAIRES TECHNIQUES EN RIZICULTURE AQUATIQUE ET ANALYSE DES DETERMINANTS DE LEUR VARIABILITE
RESUME: Le but de cette étude était d’identifier les itinéraires techniques rizicoles des riziculteurs des deux régions Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana et de déterminer les facteurs de leur variabilité. Dans cette optique, la problématique posée était « Quels sont les déterminants des itinéraires techniques rizicoles dans le Sud Est de Madagascar ? ». Sept villages ont été choisis comme zones d’étude dont cinq à fermes de référence. Les deux autres villages ont été choisis plutard pour étendre l’étude sur les périmètres irrigués. Une méthodologie spècifique relative aux différentes estimations effecutées au cours des enquêtes sur les fermes de références et autres exploitations agricoles a alors été adoptée pour atteindre un certain niveau de précicions exigées pour actualiser la base de données olympe de BVPI/SEHP. Et un focus group a été organisé dans chaque village pour receuillir des données plausibles et fiables concernant tous les itinéraires techniques existant. Sur les sept villages étudiés, 31 d’itinéraires techniques, à simple ou double ou même triple rizicultures par an, ont alors été identifiés et analysés. La date d’arrivée des inondations, la disponibilité des rizières et leur accessibilité, la disponibilité d’argent, la disponibilité de forces de travail et les phénomènes sociaux spécifiques tels le « debaky » et le « doboky » ont été leurs principaux déterminants.
Vallée Marianina, Commune Rurale d’Ilafy, Ambatondrazaka : d’une gestion de l’eau à une gestion de territoire Région Alaotra – Mangoro, Madagascar
Résumé: La vallée Marianina est un ensemble géographique qui trouve ses limites entre la retenue du barrage de Bevava et le seuil d’Ambohiboromanga. L’ensemble du site se situe sur la Commune rurale d’Ilafy. On peut distinguer, dans cette vallée comme un peu partout autour du lac Alaotra, trois types d’unité paysagère : les tanety, les baiboho et les bas‐fonds. On retrouve dans cette vallée des phénomènes d’érosion intenses. Les sédiments érodés, en provenance des lointains bassins versants, se concentrent dans le fond de la vallée. Les rivières vont alors déborder ou les digues vont rompre sous la pression d’un flux très chargé provoquant dans les deux cas un ensablement des rizières. La vallée Marianina bénéficie depuis une cinquantaine d’année d’aménagements hydroagricoles. Plus récemment, les agriculteurs de la vallée ont pu avoir des encadrements et profiter également de politiques de vulgarisation. Les formes d’occupation de l’espace et les évolutions démographiques de la vallée sont toutes éminemment liées à l’agriculture. Originellement peuplé de joncs et de roseaux, le fond de vallée est aujourd’hui entièrement mis en culture (rizières). Cette évolution agricole est évidemment à mettre en parallèle avec l’expansion démographique que connait la vallée passant de 2542 habitants en 1960 à 17398 lors du dernier recensement de 2010. Depuis 1993, la rive gauche de la vallée bénéficie de l’eau du barrage de Bevava. Ainsi, l’ensemble de la rive gauche, environ 1000 hectares, devient un périmètre irrigué. A ce titre, ce territoire fait alors partie du réseau géré par la Fédération des Associations des Usagers du Réseau (FAUR). Pour la vallée Marianina, cinq Associations d’Usagers de l’Eau assurent en effet la gestion de leur réseau. Elles collectent également une redevance auprès des usagers pour pouvoir assurer les frais de fonctionnement de la Fédération et les frais d’entretien du réseau. Ce système n’est actuellement pas autonome puisqu’il bénéficie des financements de l’Agence Française de Développement (AFD). Régulièrement, de lourds travaux (réparation de digue) doivent être réalisés. En 2013, le contrat avec l’AFD prendra fin et la FAUR devra assumer seule toutes ses dépenses. De nombreux acteurs locaux restent sceptiques quant à la viabilité de cette autonomie financière. Il y a donc un grand pas à faire. Les fonds récoltés par la FAUR auprès de ses usagers ne pourront pas augmenter démesurément. Il faut limiter les dépenses et donc limiter les coûteux travaux. Ceci n’est envisageable que si on agit sur les origines du problème et non plus sur ses conséquences. On voit alors l’importance des liens entre les bassins versants et les périmètres irrigués pour la gestion durable de ce territoire agricole. Pour cette « bonne gestion », plusieurs outils sont à disposition des acteurs locaux. Les facilités d’obtention d’un statut foncier permises par la création des guichets fonciers dans les communes rurales pourront permettre une meilleure gestion individuelle des terres. De nouvelles acquisitions foncières sont en effet possibles dans les tanety, là d’où proviennent les problèmes d’ensablement. Ces statuts fonciers devront être associés à des mesures agro‐écologiques de mise valeur qui permettront de limiter l’érosion. L’organisation de gestion de l’eau en place fonctionne mais semble encore fragile. Il semble pourtant nécessaire de devoir élargir son domaine d’action pour aller vers des questions territoriales plus larges qui vont au‐delà de la simple gestion du périmètre irrigué. L’eau suit une logique de déclivité entre amont et aval. La gestion de l’eau devrait donc suivre la même logique que celle de l’écoulement et ce à tous les niveaux d’actions : l’usager, l’association, la fédération.
Étude prospective et qualitative sur l’occupation des sols sur le périmètre irrigué PC 15 À Ambatondrazaka – région Alaotra Mangoro
Introduction : Mission et objectifs du stage Le stage a débuté le 4 mai 2009, pour une durée de trois mois et demi. Il s’est inscrit dans le cadre de la rédaction d’un mémoire de fin d’études portant sur la gestion intégrée du sol et de l’eau. Ce stage doit permettre la validation de deux masters professionnels : le Master 2 Coopération Internationale, Action Humanitaire et Politiques de Développement ; le Master 2 Études Européennes et Affaires Internationales parcours « consultant en affaires internationales », dans le cadre d’études à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Rattachée au volet sécurisation foncière du projet BV Lac et à la Cellule Foncière Alaotra, la première phase du stage a consisté à réaliser un bilan bibliographique sur le PC 15 et la sécurisation foncière à Madagascar et dans la région Alaotra-Mangoro. Elle a permis la mise au point d’une méthodologie d’enquête. La deuxième phase a consisté en un mois et demi d’enquête sur le terrain. Enfin, les 3 dernières semaines du stage ont été consacrées à la rédaction du rapport de stage et du mémoire de fin d’études. L’objectif principal du stage était de proposer une nouvelle approche prospective et qualitative de la question foncière au Lac Alaotra, en partant de l’exemple du périmètre irrigué PC 15. L’enquête à réaliser portait initialement sur le PC 15 et la Vallée Marianina. La durée du stage étant relativement limitée, il a été décidé que l’étude porterait uniquement sur la situation de l’occupation des sols sur le périmètre irrigué.
MESURE D’IMPACT DES ACTIVITES DU PROJET BVPI-SE/HP DANS LE SUD EST DE MADAGASCAR.
Introduction : Le projet « Bassins Versants Périmètres Irrigués Sud-Est/Hauts-Plateaux » (BVPI SE/HP) est un projet de mise en valeur et de protection des bassins versants et de périmètres aménagés ou réhabilités dans les régions de Vakinankaratra, d’Amoron’i Mania, de Vatovavy Fitovinany et d’Atsimo Atsinanana. Le présent document est centré sur la mesure d’impact des actions du projet BVPI HP/SE sur les exploitations agricoles après 6 années d’action dans le Sud Est de Madagascar. Il est basé sur une modélisation des exploitations du réseau de fermes de références de la région Sud-Est, utilisant le logiciel Olympe (INRA/CIRAD/IAMM) intégrant les résultats techniques issus des bases de données du projet et revues par le personnel du projet. Les résultats issus de la modélisation nécessitent une interprétation relative (et éventuellement comparative) et non absolue pour chaque type d’exploitation revisité. Les itinéraires techniques conventionnels et SCV réellement adoptés par les paysans proviennent des données du projet dont la cohérence a été vérifiée. La modélisation implique nécessairement une certaine simplification pour une meilleure clarté des résultats.