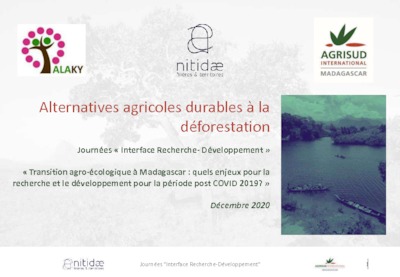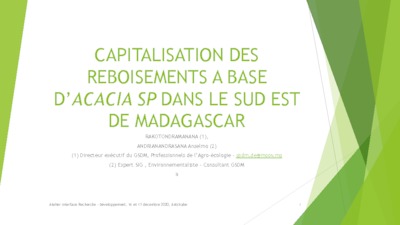REFORESTING FOR THE FUTURE GENERATIONS
REFORESTING FOR THE FUTURE GENERATIONS
MAMBOLY HAZO HO AN'NY TARANAKA MIFANDIMBY_version complète
C'est un film technique sur le reboisement et l'agroforesterie, partie intégrante de l'Agroécologie
Présentation atelier Interface Recherche et Développement 2020 Alternatives autour des Aires protégées et des Parcs nationaux : cas du projet Talaky (Anosy)
Le corridor forestier de Beampingaratsy dans la région Anosy est soumis à une forte déforestation qui participe au changement climatique et dont la première cause est la riziculture pluviale sur abbatis-brûlis. Les itinéraires culturaux pratiqués ne permettent pas l’exploitation durable des terres et, avec la démographie, ils participent à la faillite des systèmes agricoles itinérants et impactent la capacité des populations à vivre décemment de leurs terres. Le projet TALAKY, financé par l’AFD et mis en oeuvre par les ONG Nitidæ et Agrisud International dans 7 communes périphériques du massif de Beampingaratsy, allie conservation de la forêt, développement agricole et renforcement des capacités de gestion des collectivités territoriales locales pour permettre la préservation des écosystèmes naturels, la restauration des sols et l’émergence de visions d’aménagements durables. La composante agricole du projet propose aux agriculteurs riverains du massif des alternatives durables à l’exploitation des sols forestiers. La compréhension de l’utilisation traditionnelle des parcelles défrichées a permis de définir trois niveaux d’intervention : 1. Les terres agricoles : Dans les systèmes traditionnels, les terres sont exploitées chaque année sans fertilisation d’abord en riz puis en manioc à mesure que la fertilité est consommée. L’augmentation de la population ne permet plus d’assurer les temps de jachères suffisant. Le projet accompagne des aménagements à l’échelle des versants combinant lutte-antiérosive et valorisation pérenne pour ralentir la dégradation des espaces agricoles. La construction de micro-périmètres irrigués permet également d’améliorer le potentiel rizicole de la zone. 2. Les exploitations agricoles : les agriculteurs sont accompagnés dans l’évolution de leurs exploitations dans une perspective agroécologique et économique durable. Il s’agit d’améliorer les itinéraires techniques de cultures déjà présentes (SRA, basket-compost, rotations et associations) mais aussi de diversifier les exploitations pour améliorer leurs revenus (agroforesterie, gingembre, micropeuplements forestiers) et leur résilience (introduction et utilisation des plantes de services). 3. Les services agricoles à l’amont et à l’aval : du fait de son enclavement et des faibles moyens financiers des agriculteurs, les services agricoles sont peu développés. Le projet accompagne l’acquisition de compétences et/ou la formalisation de services contribuant au développement des alternatives durables. Il s’agit de producteurs d’intrants (pépiniéristes, PMS), de traitement post-récolte (batteuse, décortiqueuse) ou d’organisations professionnelles pour valoriser les produits à haute-valeur ajoutée (coopérative négoce de baie rose). S’il est possible de mesurer les actions entreprises auprès des producteurs et de suivre l’évolution de la déforestation, les liens de causalité entre ces éléments ne sont pas évidents à affirmer. La déforestation est due à des causes multiples qui se situent autour de l’économie, de la gestion lignagère, de facteurs socio-culturels, etc. De plus, les réalités sociales et légales (gestion du foncier) peuvent être très variables d’un village à l’autre d’où des variations également dans les motifs d’exploitations de la forêt. La présentation alimentera les réflexions de la journée en proposant quelques solutions apportées par le Développement (=réussites des programmes PHCF puis Talaky) à ce problème complexe, mais aussi en présentant quelques pistes d’études pour le secteur de la Recherche qui pourraient aider à résoudre certaines difficultés rencontrées.
Présentation atelier Interface Recherche et Développement 2020 : Capitalisation des reboisements à base d’Acacia sp dans le Sud Est de Madagascar
Le Sud Est de Madagascar, régions Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana, deux régions de climat subtropicale humide, est soumis à des cultures sur brulis répétitifs dans un contexte d’extrême pauvreté. La tendance durant les trois décennies était la disparition de la forêt primaire laissant la place à une savane arborée puis à une steppe à Aristida sp rabougri. Notre emblématique Ravinala affiche une résilience face aux feux mais disparaît aussi malheureusement après plusieurs feux répétitifs. L’extrême pauvreté dans ces régions du Sud Est aggravée par une explosion démographique inquiétante en milieu rural pose la question de comment nourrir ces populations tout en reconstituant la forêt. C’est là l’enjeu de l’Agro-écologie. Dans certaines communes, en particulier dans la région Vatovavy Fitovinany, on assiste déjà à un début de désertification avec apparition de monticule à crête décapée. La pluviométrie a drastiquement diminué et on commence à avoir apparaître des mois très secs entre les mois de mai et octobre. En raison de la pression sur les forêts naturelles qui n’arrivent plus à répondre aux besoins croissants des populations, beaucoup de pays ont opté pour des espèces à croissance rapide. C’est le cas, en particulier pour l’Indonésie qui a opté pour l’Acacia mangium, une légumineuse à croissance rapide, une espèce originaire de la forêt tropicale humide de la partie Nord Est de l’Australie, de la Papou Nouvelle Guinée et de l’Indonésie. Le reboisement avec l’Acacia mangium a été testé avec succès dans plusieurs régions de Madagascar, en particulier dans les régions à pluviométrie élevée (supérieure à 1500 mm) et même dans le Moyen Ouest du Vakinankaratra dans le cadre du projet MANITATRA où la pluviométrie est inférieure à 1200 mm. D’autres espèces d’Acacia ont été testées dans d’autres régions de Madagascar, en particulier l’A. holosericea, testé par le PLAE dans des sols dégradés dans les régions à longue saison sèche comme le Boeny. L’intérêt de l’Acacia mangium réside dans sa croissance rapide mais en plus, étant une légumineuse à forte production de biomasse, des paysans utilisent ses feuilles dans les composts. Son intérêt en tant que plante mellifère est reconnu par les paysans dans le Sud Est, qui parfois, la plantent uniquement dans cet objectif. Dans les régions cycloniques, nous avons constaté que l’Acacia mangium se diffuse tout seul par les vents, en particulier lors des cyclones. Après un passage de feu, les graines germent et reprennent très vite. L’objet de cet article est de partager, essentiellement au moyen d’images, les impacts de l’introduction de l’Acacia mangium dans le Sud Est dans le cadre des actions dans le site de l’ONG TAFA près du fleuve Faraony avec encadrement du GSDM et du CIRAD. Au vu des premiers résultats de ce site sur une steppe à Aristida dégradé, tous les reboisements successifs des projets sur l’axe de la RN 12 et une partie de l’axe Farafangana - Vonindrozo ont mis l’accent sur cette espèce. Compte tenu de ses succès, l’Acacia mangium devrait être promu dans les corridors forestiers (COFAV, COMATSA, ANDASIBE ZAHAMENA..).
Reboisons pour les générations futures
Il s'agit d'un publireportage sur les exploits du GSDM en termes d'activité de reboisement. L'article est paru dans l'Express de Madagascar le 15 et 16 mars 2019.