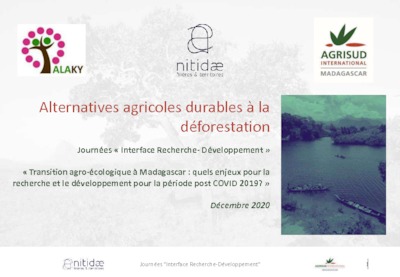données de capitalisations et de témoignages de paysans en fin de projets mais aussi des projets en cours dans une des régions menacées de désertification comme le Bongolava. Il s’avère que la gestion durable des terres face au changement climatique et dans un contexte de pauvreté et de mal nutrition fait appel surtout aux bonnes pratiques agricoles, entre autres les composts et les différentes plantes de services dont on dispose d’expériences éprouvées dans les différéntes zones agroécologiques du Pays. Les formations à différents niveaux et les communications par différents canaux ont permis des échanges fructueux entre producteurs, renforcées par le nombre important de visites échanges appuyés par les projets. Il est de plus en plus confirmé que les échanges entre paysans sont les plus efficaces en termes de diffusions des innovations techniques. La diffusion très rapide des systèmes à base de mucuna et de lombricompost en accompagnement du riz pluvial en est un exemple parmi tant d’autres. Relatées dans ce journal, les expériences des autres pays en agriculture biologique nous inspirent, même si les opportunités ne sont pas les mêmes, notamment en ce qui concerne les SPG et les TVAB. Nous constations qu’il y de plus en plus d’intérêts à publier dans le Journal de l’Agroécologie, ce qui nous motive à le soutenir par les moyens dont nous disposons. Nous remercions tous les chercheurs, tous les développeurs de plusieurs régions de Madagascar d’avoir répondu à notre appel à publications.
JOURNAL DE L'AGROECOLOGIE EDITION 13
JOURNAL DE L'AGROECOLOGIE EDITION 13
données de capitalisations et de témoignages de paysans en fin de projets mais aussi des projets en cours dans une des régions menacées de désertification comme le Bongolava. Il s’avère que la gestion durable des terres face au changement climatique et dans un contexte de pauvreté et de mal nutrition fait appel surtout aux bonnes pratiques agricoles, entre autres les composts et les différentes plantes de services dont on dispose d’expériences éprouvées dans les différéntes zones agroécologiques du Pays. Les formations à différents niveaux et les communications par différents canaux ont permis des échanges fructueux entre producteurs, renforcées par le nombre important de visites échanges appuyés par les projets. Il est de plus en plus confirmé que les échanges entre paysans sont les plus efficaces en termes de diffusions des innovations techniques. La diffusion très rapide des systèmes à base de mucuna et de lombricompost en accompagnement du riz pluvial en est un exemple parmi tant d’autres. Relatées dans ce journal, les expériences des autres pays en agriculture biologique nous inspirent, même si les opportunités ne sont pas les mêmes, notamment en ce qui concerne les SPG et les TVAB. Nous constations qu’il y de plus en plus d’intérêts à publier dans le Journal de l’Agroécologie, ce qui nous motive à le soutenir par les moyens dont nous disposons. Nous remercions tous les chercheurs, tous les développeurs de plusieurs régions de Madagascar d’avoir répondu à notre appel à publications.
Présentation atelier Interface Recherche et Développement 2020 Alternatives autour des Aires protégées et des Parcs nationaux : cas du projet Talaky (Anosy)
Le corridor forestier de Beampingaratsy dans la région Anosy est soumis à une forte déforestation qui participe au changement climatique et dont la première cause est la riziculture pluviale sur abbatis-brûlis. Les itinéraires culturaux pratiqués ne permettent pas l’exploitation durable des terres et, avec la démographie, ils participent à la faillite des systèmes agricoles itinérants et impactent la capacité des populations à vivre décemment de leurs terres. Le projet TALAKY, financé par l’AFD et mis en oeuvre par les ONG Nitidæ et Agrisud International dans 7 communes périphériques du massif de Beampingaratsy, allie conservation de la forêt, développement agricole et renforcement des capacités de gestion des collectivités territoriales locales pour permettre la préservation des écosystèmes naturels, la restauration des sols et l’émergence de visions d’aménagements durables. La composante agricole du projet propose aux agriculteurs riverains du massif des alternatives durables à l’exploitation des sols forestiers. La compréhension de l’utilisation traditionnelle des parcelles défrichées a permis de définir trois niveaux d’intervention : 1. Les terres agricoles : Dans les systèmes traditionnels, les terres sont exploitées chaque année sans fertilisation d’abord en riz puis en manioc à mesure que la fertilité est consommée. L’augmentation de la population ne permet plus d’assurer les temps de jachères suffisant. Le projet accompagne des aménagements à l’échelle des versants combinant lutte-antiérosive et valorisation pérenne pour ralentir la dégradation des espaces agricoles. La construction de micro-périmètres irrigués permet également d’améliorer le potentiel rizicole de la zone. 2. Les exploitations agricoles : les agriculteurs sont accompagnés dans l’évolution de leurs exploitations dans une perspective agroécologique et économique durable. Il s’agit d’améliorer les itinéraires techniques de cultures déjà présentes (SRA, basket-compost, rotations et associations) mais aussi de diversifier les exploitations pour améliorer leurs revenus (agroforesterie, gingembre, micropeuplements forestiers) et leur résilience (introduction et utilisation des plantes de services). 3. Les services agricoles à l’amont et à l’aval : du fait de son enclavement et des faibles moyens financiers des agriculteurs, les services agricoles sont peu développés. Le projet accompagne l’acquisition de compétences et/ou la formalisation de services contribuant au développement des alternatives durables. Il s’agit de producteurs d’intrants (pépiniéristes, PMS), de traitement post-récolte (batteuse, décortiqueuse) ou d’organisations professionnelles pour valoriser les produits à haute-valeur ajoutée (coopérative négoce de baie rose). S’il est possible de mesurer les actions entreprises auprès des producteurs et de suivre l’évolution de la déforestation, les liens de causalité entre ces éléments ne sont pas évidents à affirmer. La déforestation est due à des causes multiples qui se situent autour de l’économie, de la gestion lignagère, de facteurs socio-culturels, etc. De plus, les réalités sociales et légales (gestion du foncier) peuvent être très variables d’un village à l’autre d’où des variations également dans les motifs d’exploitations de la forêt. La présentation alimentera les réflexions de la journée en proposant quelques solutions apportées par le Développement (=réussites des programmes PHCF puis Talaky) à ce problème complexe, mais aussi en présentant quelques pistes d’études pour le secteur de la Recherche qui pourraient aider à résoudre certaines difficultés rencontrées.
Présentation atelier Interface Recherche et Développement 2020 : Les pratiques agroecologiques : freins et levier à l’adoption par les producteurs
A Madagascar, la productivité des exploitations est souvent faible et les techniques employées menacent la qualité et la quantité des ressources naturelles disponibles, dans un contexte de changement climatique impactant la résilience des agrosystèmes. De fait, les exploitants ont recours à des pratiques agricoles peu durables pour maintenir ou augmenter la production et subvenir aux besoins d’une population toujours plus nombreuse. Dans le cadre de ses différents projets, Agrisud International et ses partenaires diffusent des systèmes de cultures/élevages agroécologiques, permettant une gestion durable de la fertilité des sols et une augmentation durable de la productivité et de la résilience agricole. Tout en tenant compte des caractéristiques et des contraintes spécifiques des zones d’intervention, une dizaine de pratiques agroécologiques de base ont fait l’objet d’une étude spécifique : il a été constaté que ces pratiques agroécologiques sont en général appréciées par les producteurs, mais les niveaux d’adoption de ces pratiques different entre régions, et entre producteurs d’une même région, alors que les moyens et méthodes de diffusion sont similaires. Ainsi, pour mieux comprendre ces différences et pour mener une stratégie de diffusion et d’accompagnement adéquate, Agrisud a mené des analyses comparatives de données et d’informations issues de différentes Régions, influençant l’adoption de ces pratiques. Les résultats des analyses ont mis en évidence des ressemblances mais aussi quelques différences entre les zones étudiées. Le niveau d’adoption est influencé par des facteurs externes à l’exploitation tels que la disponibilité de biomasse végétale nécessaire à la fabrication du compost et des biofertilisants liquides, le niveau de fertilité et d’érosion du sol. Mais il y a aussi l’influence des facteurs internes à l’exploitation comme l’effet des pratiques sur le rendement des cultures et la trésorerie de l’exploitation. Les freins à l’adoption des pratiques agroécologiques sont eux, souvent liés à des aspects socioéconomiques internes à l’exploitation (disponibilité de main d’oeuvre et des matériels agricoles, connaissances techniques des exploitants) ou liés à son environnement socio-culturel immédiat (pratique de feux de brousse, vols de zébus, sécurité foncière). La présentation conclut sur la pertinence et les liens à faire dans la mise en oeuvre des actions de développement ciblées sur une zone d’intervention (au niveau des exploitations agricoles ou au niveau du territoire). Celles-ci sont renforcées par les décisions et actions politiques en faveur d’un développement agricole durable et constituent des leviers complémentaires et efficaces pour appuyer le développement d’une agriculture durable.