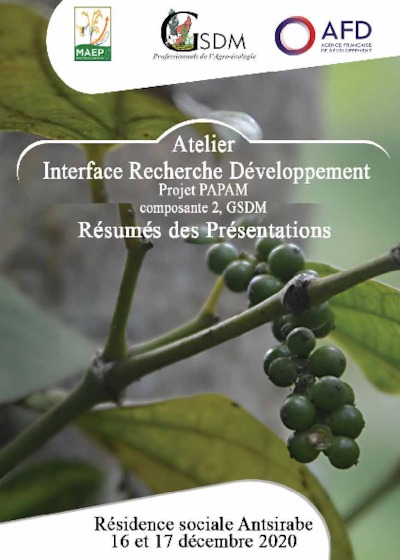Ce numéro rapporte, entre autres, les actions en cours en termes d’Agroécologie au niveau national ou au niveau régional. Dans ce cadre en particulier, il y a lieu de citer les actions concrètes en cours dans la mise à l’échelle des blocs agroécologiques dans le Sud au travers de différents projets et associant le CTAS, l’ONG qui a mis au point ces techniques avec le GRET avec l’appui du GSDM. Dans ces blocs agroécologiques, à part les haies vives de Cajanus dont les graines sont consommées au même titre que le haricot après avoir été tabous dans certaines communes, des espèces adaptées à la sécheresse sont promues comme les sorghos, le mil ou le konoke. Au niveau national, les actions de restauration des sols dégradés aussi bien au niveau du développement que de la recherche continuent pour permettre la mise en culture de cultures vivrières notamment du riz pluvial. Les donnsées de la recherche sur le lombricompost sont très intéressantes dans un contexte de coûts élevés d'intrants pour les EAF. De même, sous l’impulsion d’un membre du GSDM, le WWF, le réseau Natural Capital (Nat Cap) Madagascar est présenté dans ce journal, un réseau composé d’acteurs de la société civile, du secteur privé, du milieu académique et du secteur public qui s’est donné comme mission de promouvoir la considération et l’intégration du capital naturel dans les processus de prise de décisions et dans les actions de tous les acteurs de développement dans différents secteurs.
JOURNAL DE L'AGROECOLOGIE EDITION 14
JOURNAL DE L'AGRO-ECOLOGIE EDITION N°9
Ce numéro 9 du Journal de l’Agro-écologie couvre différents domaines allant de la recherche à la formation, aux enjeux de développement et surtout, par rapport aux numéros précédents, des témoignages d’adoptants montrant des changements de comportements sur les bonnes pratiques agricoles pour la gestion de la fertilité des sols. On connaît depuis longtemps l’importance de la matière organique dans nos sols acides fortement lessivés depuis de longues années. Un sol ferralitique acide dépourvu de matière organique se compacte à partir des 15 cm limitant la descente des racines des plantes. Sur ces sols acides le fumier est un amendement très utile dont la fonction va bien au-delà de sa composition chimique à savoir sa fonction dans le relèvement du pH et sa fonction dans le complexe argilo-chimique. Jusqu’à présent, on s’est appuyé sur le fumier de ferme mais avec la forte réduction du troupeau dans les exploitations agricoles, il est impossible de satisfaire les besoins. En effet, les productions de fumier dans les exploitations agricoles (inférieures à 5 t/ha) sont nettement insuffisantes pour satisfaire leur besoin. Comme le fumier ne sera jamais suffisant, la solution c’est les plantes de couverture où nous avons des acquis énormes par rapport aux autres pays. L’engouement des paysans du projet MANITATRA sur le mucuna et le lombricompost est très significatif à cet égard. A noter également l’utilisation du compost liquide avec addition de plantes biocides comme le neem, le faux neem, etc.. pour lutter contre les insectes nuisibles. L’autre solution complémentaire est l’utilisation des composts et en particulier le lombricompost, une matière organique de qualité qui s’utilise à des doses dix fois plus faibles que le fumier.
JOURNAL DE L'AGRO-ECOLOGIE EDITION N°8
Ce numéro 8 du Journal de l’Agro-écologie couvre différents domaines allant de la recherche à la formation, aux enjeux de développement et surtout, par rapport aux numéros précédents, des témoignages d’adoptants montrant des changements de comportements sur les bonnes pratiques agricoles pour la gestion de la fertilité des sols. La reconnaissance de l’importance du fumier de ferme améliorée dans la Sud Est est très significative à cet égard et traduit un changement de paradigme dans la gestion de la fertilité des sols pour des paysans qui ne l’utilisaient pas du tout dans le passé. Il en est de même pour la restitution des résidus des récoltes d’après les enquêtes de la recherche. Différentes innovations figurent dans ce numéro, entre autres les contributions des techniques agro-écologiques pour améliorer la sécurité alimentaire aux alentours des aires protégées, la valorisation des déchets urbains pour ajouter l’intensification des cultures à forte valeur ajoutée. A noter en particulier la confirmation de l’importance du mucuna d’après les expériences de nos partenaires autour des aires protégées : le mucuna associé aux cultures vivrières réduit aussi les attaques de sangliers, par conséquent, en plus de ses propriétés avérées dans la régénération de la fertilité, dans la lutte contre les mauvaises herbes, dans sa forte capacité à réduire les attaques des insectes dont en particulier les chenilles légionnaires, le mucuna est aussi un répulsif contre les grands ravageurs des cultures comme les sangliers (observations préliminaires). Les travaux de recherche contribuent largement dans ce numéro dans l’éclairage sur l’adoption ou la non adoption des techniques diffusées.
JOURNAL DE L'AGROECOLOGIE EDITION 14
Ce numéro rapporte, entre autres, les actions en cours en termes d’Agroécologie au niveau national ou au niveau régional. Dans ce cadre en particulier, il y a lieu de citer les actions concrètes en cours dans la mise à l’échelle des blocs agroécologiques dans le Sud au travers de différents projets et associant le CTAS, l’ONG qui a mis au point ces techniques avec le GRET avec l’appui du GSDM. Dans ces blocs agroécologiques, à part les haies vives de Cajanus dont les graines sont consommées au même titre que le haricot après avoir été tabous dans certaines communes, des espèces adaptées à la sécheresse sont promues comme les sorghos, le mil ou le konoke. Au niveau national, les actions de restauration des sols dégradés aussi bien au niveau du développement que de la recherche continuent pour permettre la mise en culture de cultures vivrières notamment du riz pluvial. Les donnsées de la recherche sur le lombricompost sont très intéressantes dans un contexte de coûts élevés d'intrants pour les EAF. De même, sous l’impulsion d’un membre du GSDM, le WWF, le réseau Natural Capital (Nat Cap) Madagascar est présenté dans ce journal, un réseau composé d’acteurs de la société civile, du secteur privé, du milieu académique et du secteur public qui s’est donné comme mission de promouvoir la considération et l’intégration du capital naturel dans les processus de prise de décisions et dans les actions de tous les acteurs de développement dans différents secteurs.
JOURNAL DE L'AGRO-ECOLOGIE EDITION N°9
Ce numéro 9 du Journal de l’Agro-écologie couvre différents domaines allant de la recherche à la formation, aux enjeux de développement et surtout, par rapport aux numéros précédents, des témoignages d’adoptants montrant des changements de comportements sur les bonnes pratiques agricoles pour la gestion de la fertilité des sols. On connaît depuis longtemps l’importance de la matière organique dans nos sols acides fortement lessivés depuis de longues années. Un sol ferralitique acide dépourvu de matière organique se compacte à partir des 15 cm limitant la descente des racines des plantes. Sur ces sols acides le fumier est un amendement très utile dont la fonction va bien au-delà de sa composition chimique à savoir sa fonction dans le relèvement du pH et sa fonction dans le complexe argilo-chimique. Jusqu’à présent, on s’est appuyé sur le fumier de ferme mais avec la forte réduction du troupeau dans les exploitations agricoles, il est impossible de satisfaire les besoins. En effet, les productions de fumier dans les exploitations agricoles (inférieures à 5 t/ha) sont nettement insuffisantes pour satisfaire leur besoin. Comme le fumier ne sera jamais suffisant, la solution c’est les plantes de couverture où nous avons des acquis énormes par rapport aux autres pays. L’engouement des paysans du projet MANITATRA sur le mucuna et le lombricompost est très significatif à cet égard. A noter également l’utilisation du compost liquide avec addition de plantes biocides comme le neem, le faux neem, etc.. pour lutter contre les insectes nuisibles. L’autre solution complémentaire est l’utilisation des composts et en particulier le lombricompost, une matière organique de qualité qui s’utilise à des doses dix fois plus faibles que le fumier.
JOURNAL DE L'AGRO-ECOLOGIE EDITION N°8
Ce numéro 8 du Journal de l’Agro-écologie couvre différents domaines allant de la recherche à la formation, aux enjeux de développement et surtout, par rapport aux numéros précédents, des témoignages d’adoptants montrant des changements de comportements sur les bonnes pratiques agricoles pour la gestion de la fertilité des sols. La reconnaissance de l’importance du fumier de ferme améliorée dans la Sud Est est très significative à cet égard et traduit un changement de paradigme dans la gestion de la fertilité des sols pour des paysans qui ne l’utilisaient pas du tout dans le passé. Il en est de même pour la restitution des résidus des récoltes d’après les enquêtes de la recherche. Différentes innovations figurent dans ce numéro, entre autres les contributions des techniques agro-écologiques pour améliorer la sécurité alimentaire aux alentours des aires protégées, la valorisation des déchets urbains pour ajouter l’intensification des cultures à forte valeur ajoutée. A noter en particulier la confirmation de l’importance du mucuna d’après les expériences de nos partenaires autour des aires protégées : le mucuna associé aux cultures vivrières réduit aussi les attaques de sangliers, par conséquent, en plus de ses propriétés avérées dans la régénération de la fertilité, dans la lutte contre les mauvaises herbes, dans sa forte capacité à réduire les attaques des insectes dont en particulier les chenilles légionnaires, le mucuna est aussi un répulsif contre les grands ravageurs des cultures comme les sangliers (observations préliminaires). Les travaux de recherche contribuent largement dans ce numéro dans l’éclairage sur l’adoption ou la non adoption des techniques diffusées.
Livret des résumés_Atelier Interface Recherche et Développement 2020
Sont également invités à partager leurs expériences/résultats de leur recherche les grandes exploitations et les acteurs de l’Agriculture Biologique. Thématiques de présentations suivi de question-réponses 1. L’Agro-écologie en réponse aux enjeux du changement climatique et la sécurité alimentaire 2. Quels systèmes de production Post COVID 19 en réponse à la sécurité alimentaire 3. La gestion durable des terres (GDT) en lien avec la productivité agricole et la lutte contre la désertification 4. Quelles alternatives autour des Aires protégées et des Parcs nationaux 5. L’Agriculture biologique, enjeux, opportunités pour les petits producteurs
Présentation atelier Interface Recherche et Développement 2020 : Comment limiter l’apparition de flétrissement bactérien causé par Xanthomonas oryzae pv. oryzae sur le plan du contexte agro-écologique ?
Le riz est la culture vivrière principale et constitue l’alimentation de base de la population malgache. La culture de ce céréale traverse des nombreuses contraintes abiotiques et biotiques. Une des maladies la plus dévastatrice du riz dans le monde est le flétrissement bactérien ou « Bactérial Leaf Blight (BLB) » causé par Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) qui peut entrainer une perte de récolte allant jusqu’à plus de 70%. A Madagascar, le BLB n’a pas été recensé auparavant d’après la prospection des maladies du riz effectuée par différentes équipes de phytopathologiste en 1985 et 2013. Pourtant, la présence d’attaque de Xoo a été observée sur des tanety et bas fonds à Ivory (Moyen Ouest de Vakinankaratra) par l’observation des symptômes sur les feuilles attaquées pendant la campagne 2018-2019. Des analyses moléculaires faites au laboratoire ont permis de confirmer l’apparition de BLB à Madagascar. Durant la saison culturale 2019-2020, trois sites expérimentaux et des parcelles de producteurs dont Antsirabe, Ivory, et Morafeno ont été touchés par cette maladie. L’objectif de la présentation est d’analyser l’effet de la maladie sur des lignées de riz pluvial conduite dans deux expérimentations avec plusieurs niveaux de fertilité et différentes gestions agro-écologiques. L’une sur un essai avec 55 lignées du programme SCRiD comprenant deux conditions contrastant de fertilité F0 sans apport et FM avec fertilisation minérale. D’autre sur un essai agronomique du projet EcoAfrica sous différents lots de traitements (quatre variétés vulgarisées, quatre doses d’inoculation mychorizienne et quatre niveaux de fertilisation phosphatée). Les résultats montrent que les réponses des variétés diffèrent significativement entre elles vis-à-vis du Xoo dans les deux dispositifs expérimentaux à Ivory. L’analyse peut en déduire une perte de récolte à cause de BLB, mais la perte dépend de la phase d’initiation de BLB. Quand la maladie apparait tôt, plus la perte est importante. L’analyse d’attaque de BLB montre aussi que la maladie est plus sévère sur des parcelles à fertilisation élevée par rapport aux parcelles à faible fertilisation. Les résultats avec l’inoculation mychorizienne ne montrent aucun effet de ce facteur sur la sévérité de BLB. Un système d’alerte a été mis en place par la formation des techniciens, agents vulgarisateurs et riziculteurs, groupements paysan ; par la distribution des fiches et des posters et par l’explication du BLB durant la réunion mensuelle des Maires dans les Districts de la région du Vakinankaratra afin de favoriser des échanges d’informations permettront de cartographier les zones touchées par cette maladie. La compréhension approfondie de l’épidémie de BLB sous différent contexte agro-éologique (par exemple le système de culture sous couverture végétale qui réduit l’attaque de la pyriculariose, par contre des études devraient être conduites si ce système limite ou favorise l’attaque de BLB), l’identification et l’utilisation des variétés résistantes et l’analyse des populations du pathogène aideront beaucoup à la formulation de la gestion de cette maladie bactériènne du riz qui constitue un nouveau danger pour la rizicutlure à Madagascar
JOURNAL DE L'AGRO-ECOLOGIE EDITION N°7 OCTOBRE A DÉCEMBRE 2018
Ce numéro 7 du Journal de l’Agro-écologie couvre différents domaines allant de la recherche à la formation et aux enjeux de développement. Sont développés, entre autres, des sujets d’actualité comme les perspectives offertes par les plantes de couvertures dans la régénération des sols dégradés voire dans la lutte contre les chenilles légionnaires ou l’analyse des exploitations agricoles familiales pour mieux orienter le développement. Dans l’amélioration des sols par les plantes améliorantes, la performance du pois d’Angole (Cajanus cajan) sur des sols très compactés du Nord-Ouest est confirmée par la recherche. D’ailleurs, la contribution de la recherche privée dans l’amélioration de sols très dégradés en lien avec l’initiative d’exploitation à grande échelle de cajou est partagée dans ce numéro. Des témoignages de paysans dans des régions d’extrême pauvreté sur la contribution des techniques agro-écologiques dans la sécurité alimentaire sont aussi dans ce numéro.
Présentation du DP SPAD (volet recherche) sur la conception participative de Systèmes de Culture innovants dans le Moyen-Ouest du Vakinankaratra (MOV) - Atelier recherche développement 25 janvier 2018 à Antsirabe
Présentation du DP SPAD (volet recherche) sur la conception participative de Systèmes de Culture innovants dans le Moyen-Ouest du Vakinankaratra (MOV) - Atelier recherche développement 25 janvier 2018 à Antsirabe