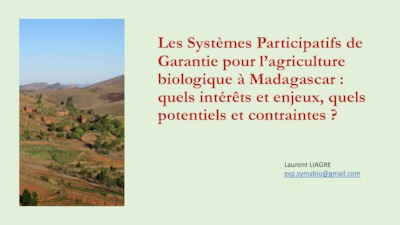Une présentation lors du FIA 2024 à la salle de conférence,coanimé par SYMABIO et l'opérateur privé FALY EXPORT . Une présentation mettant en valeur que l'agriculture durable est essentielle pour répondre aux défis mondiaux contemporains. En combinant divers principes, pratiques et modèles, il est possible de créer un système alimentaire qui soit respectueux de l'environnement, économiquement viable, et socialement équitable. Les initiatives à Madagascar, ainsi que dans d'autres régions, peuvent servir de modèle pour d'autres pays et communautés cherchant à adopter des pratiques agricoles durables et résilientes.
FIA 2024 - Conférence Agriculture Durable avec SYMABIO et l'opérateur privé FALY EXPORT
Rapprochement_Agroécologie_AB_Transition_agroécologique
Une présentation faite par le Directeur Exécutif de GSDM Tahina RAHARISON et le chef de projet Tovohery, chef de Projet KHEA/KCOA. Cet document met en lumière la complémentarité entre l'agroécologie et l'agriculture biologique. Bien que ces deux mouvements aient des approches différentes, il est crucial d'établir un rapprochement pour renforcer la transition agroécologique. Cela inclut l'intégration des pratiques agroécologiques dans le marché et le développement de systèmes de reconnaissance pour valoriser les produits.
Présentation atelier Interface Recherche et Développement 2020 :Les Systèmes Participatifs de Garantie pour l’agriculture biologique, quels intérêts et enjeux, quels potentiels et quelles contraintes à leur promotion à Madagascar ?
La Loi n° 2020-003 sur l’Agriculture biologique à Madagascar promulguée le 3 juillet 2020 reconnait pleinement les Systèmes Participatifs de Garantie comme garant du caractère biologique des produits vendus sur les marchés nationaux et de manière complémentaire à la certification par tiers exigée par les grands marchés d’exportation. La définition donnée dans la loi renvoie à la définition internationalement reconnue par l’IFOAM et la FAO : « Système d’assurance qualité ancré localement qui garantit qu’un produit agricole, d’élevage, forestier, aquatique ou issu de cueillette en zones naturelles est conforme à des conditions de production, de cueillette, de ramassage, de préparation et d’étiquetage fixées par des normes et cahiers des charges relatifs à l’Agriculture biologique. A la différence de la certification par tiers, le système participatif de garantie repose sur la participation active des acteurs directement impliqués dans la production et la préparation des produits concernés : producteurs, préparateurs, consommateurs ». L’ambition de la loi - et au-delà de la Stratégie Nationale pour le développement de l’Agriculture Biologique en cours de conception - est donc de promouvoir le développement du marché biologique national comme complément indispensable et en synergie avec le soutien à la croissance des exportations de produits biologiques. A cet égard, l’approche réglementaire adoptée dans la loi vise à garantir le caractère biologique des produits mis sur les marchés (au bénéfice des consommateurs) sans entraver la croissance du secteur. La loi propose ainsi le cadre pour la production et la mise en marché pour le marché intérieur avec entre autres l’ouverture au développement d’une filière locale avec des exigences adaptées reposant sur la mise en place d’un cahier des Charges national et la reconnaissance des Systèmes de Garantie Participative potentiellement plus accessibles pour les petits producteurs du fait de la réduction de deux barrières à l’entrée : la disparition du coût de la certification par tiers et la facilité de contrôle pour des agriculteurs peu rompus aux lourdeurs administratives. En outre le contrôle croisé du respect du cahier des charges par les producteurs eux-mêmes est source d’apprentissage et d’innovations techniques par la confrontation et la mise en débat des pratiques face aux contraintes agronomiques rencontrées par les producteurs. Pour autant, le marché domestique des produits biologiques est encore embryonnaire à Madagascar. Des SPG existent à l’état de prémisse en zones périurbaines de la capitale et concernent plusieurs centaines de petits agriculteurs engagés dans la production de produits frais maraichers, avant tout selon les techniques agroécologiques, plutôt que strictement biologiques. Par ailleurs, se pose la question de la demande en produits biologiques chez les consommateurs malgaches. Les acheteurs actuels des produits biologiques se caractérisent souvent par un pouvoir d’achat élevé (étrangers expatriés, classes moyennes et supérieures malgaches) et ayant déjà une relative connaissance de ce que signifie le terme bio. Pourtant, les consommateurs urbains au pouvoir d’achat plus réduit sont potentiellement soucieux et désireux d’accéder à des aliments sains et naturels, et ont des pratiques d’achat et de consommation en conséquence, même si les produits ne sont pas certifiés. Ainsi, des études de marché pour caractériser le potentiel de développement des produits agroécologiques et biologiques garantis dans les principaux centres urbains du pays constituent un point de passage nécessaire dans une perspective de développement des SPG à Madagascar. Elles permettront d’affiner les stratégies de production locale et de certification adaptée pour les petits producteurs et d’information des consommateurs, dans une optique générale de permettre la démocratisation de l’accès en confiance aux produits biologiques et agroécologiques.
Présentation atelier Interface Recherche et Développement 2020 : Territoire à vocation biologique, un concept législatif à opérationnaliser avec les acteurs locaux avant toute tentative de définition ?
La Loi n° 2020-003 sur l’Agriculture biologique à Madagascar promulgué le 3 juillet 2020 est porteuse du concept de Territoire à Vocation Agriculture Biologique (TVB), présenté comme des « Territoires dans les cadres desquels des partenariats public-privés sont encouragés pour faciliter le développement de la production biologique, et ce notamment dans les périphéries des aires protégées, les zones à forte propension à l’Agriculture biologique, ou encore les zones péri-urbaines au potentiel identifié pour l’approvisionnement des marchés domestiques notamment en produits biologiques frais. » Même s’il fait écho à d’autres initiatives de développement de projets alimentaires territoriaux par le monde, ce concept succinctement défini dans la loi trouve ses racines à Madagascar dans la volonté initiale des opérateurs de l’exportation à réduire, voire supprimer, les sources de contamination des productions biologiques dans les terroirs de production concernés. Mais les débats menés au moment de l’élaboration de la loi ont montré aux différentes parties prenantes l’intérêt d’ouvrir le concept à une diversité de situations potentielles, telles qu’évoquées dans la loi, pour de multiples bénéfices environnementaux, socioéconomiques et sanitaires. Avant toute définition approfondie - et dès lors prématurée - de ce concept, il s’agit avant tout de mettre en place des opérations pilote reposant sur un certain nombre de principes à discuter et valider collectivement. Dès lors, il s’agira de tester dans ces différents contextes comment allier le développement des filières biologiques et des territoires afin d’alimenter les réflexions politiques en cours sur la définition des territoires à vocation biologique à Madagascar. L’ambition est de montrer comment le dialogue entre les différentes catégories d’acteurs – collectivités, entreprises, producteurs et leurs organisations, services techniques - et les dynamiques partenariales peuvent créer un effet de levier pour le développement d’un territoire et contribuer au développement d’une agriculture rentable, socialement inclusive, contribuant à la préservation de l’environnement et des ressources naturelles et générant des produits alimentaires de qualité et compétitifs sur les marchés internationaux et domestiques. A terme, idéalement, il s’agirait de mutualiser et de confronter les différents référentiels techniques existant à Madagascar à travers des processus de capitalisation et de mise en débat des différentes expériences d’accompagnement des producteurs et de développement des chaines de valeur agroécologiques et biologiques à l’échelle des territoires pour définir les critères, le cahier des charges, les mécanismes de contrôle et les dispositifs de suivi qui pourraient être constitutifs d’un futur label « territoire à vocation biologique».