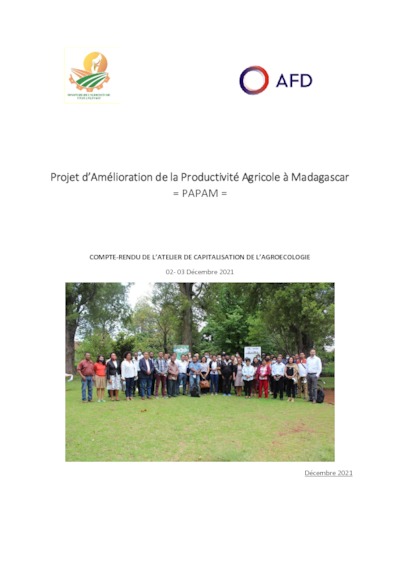1 - Présentation_r_d_SANUVA-Sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages agricoles dans le Vakinankaratra
1 - Présentation_r_d_SANUVA-Sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages agricoles dans le Vakinankaratra
COMPTE-RENDU DE L’ATELIER DE CAPITALISATION DE L’AGROECOLOGIE_02- 03 Décembre 2021
A la veille de la clôture du projet PAPAM, le GSDM a organisé un atelier de capitalisation regroupant les acteurs de développement de la Composante 2 : « Appui à l’intensification agricole dans le cadre d’une approche BVPI » pour avoir une situation de l’AE dans les 4 régions d’intervention du Projet : Vakinankaratra, Alaotra Mangoro, Vatovavy-Fitovinany, Atsimo Atsinanana. L’atelier s’est tenu à la Résidence Sociale Antsirabe les 02-03 décembre 2021. Il a regroupé 70 participants dont : des représentants des Régions, des représentants des Directions Régionales de l’Agriculture et de l’Elevage (DRAE), les ONG partenaires de PAPAM - Opérateurs d’Appui à la diffusion de l’Agroécologie, les responsables des Composantes et représentants du Projet PAPAM au sein du Ministère de Tutelle Centrale.
Bâche de formation GSDM, LE BASKET COMPOST
Il s'agit d'un support de formation utilisé pour l'apprentissage de l’Agro-écologie au niveau des 8 collèges bénéficiaires de l'intégration de l'Agro-écologie en milieu scolaire dans la région Boeny (projet GIZ/ProSol).
Bâche de formation ludique sur la courbe de niveau
Il s'agit d'un support de formation ludique utilisé dans l'enseignement de l'Agro-écologie en milieu scolaire
Bâche de formation ludique définissant l'Agro-écologie
Il s'agit d'une bâche de formation ludique qui compare l'agriculture conventionnelle à l'agro-écologie
JOURNAL DE L'AGRO-ECOLOGIE N°2
Vous lirez dans cette édition les dernières informations sur les activités liées à l’appui à la diffusion de l’Agroécologie à l’échelle nationale ainsi que des éléments de capitalisation dans le Sud-Est. Vous y découvrirez les formations en Agroécologie à différents niveaux, les résultats des recherches sur les variétés de riz pluvial, la collecte et l’intégration des données en Agroécologie au niveau national et des propositions pour y arriver, les problèmes rencontrés en terme de financement et les différentes réalisations et actions de promotion de l’Agroécologie du GSDM et de ses membres
L’agriculture contractuelle dans les pays en développement Une revue de littérature
L’agriculture contractuelle peut être envisagée comme un prêt d’« intrants » – semences, engrais, crédit ou services de vulgarisation – consenti par une entreprise à un agriculteur en contrepartie de droits d’achat exclusifs sur la récolte. C’est une forme d’intégration verticale des filières agricoles qui donne à l’entreprise un contrôle plus étroit sur le processus de production et sur le produit final. L’agriculture contractuelle suscite une considérable attention des chercheurs et des pouvoirs publics. Mais alors que les constats des travaux de recherche menés dans les années 1980 et 1990 étaient contrastés quant à la capacité de participation des petits exploitants agricoles à ces dispositifs et aux bénéfices qu’ils pouvaient en tirer, la littérature récente est nettement plus positive sur ce point. D’autre part, de récents rapports de haut niveau évaluent positivement cette forme d’innovation institutionnelle ; citons, par exemple, le Rapport sur le développement dans le monde 2008, L’Agriculture au service du développement, publié par la Banque mondiale et le Rapport sur l’investissement dans le monde 2009, Sociétés transnationales, production agricole et développement, de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Aux fins de cette revue de la littérature, l’auteur a examiné la base de données en ligne sur l’agriculture contractuelle de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et effectué des recherches bibliographiques sur Agricola, Econlit, JSTOR, le Web of Science et Eldis afin de réunir 100 articles sur l’agriculture contractuelle, dont la majorité ont été publiés depuis 2007 (voir annexes 3 - 5) ; à cela s’ajoute 12 autres études sélectionnées par l’auteur et le commanditaire de l’étude (AFD). Partant de ces travaux, cette revue examine les tendances mondiales et régionales de l’agriculture contractuelle dans les pays en développement et présente les points de vue conceptuels et théoriques au niveau méso- et micro-économique – des approches par les coûts de transaction à la gouvernance des chaînes de valeur – qui contribuent à expliquer l’intérêt croissant pour l’agriculture contractuelle par rapport à d’autres formes d’échange. La littérature générale consacrée à l’agriculture contractuelle formule cinq hypothèses à partir desquelles cette revue évalue les études empiriques les plus récentes – celles-ci relatant 35 « réussites » et neuf « échecs ». Cet exercice conduit aux constats suivants : (1) Les données récentes confortent la première hypothèse selon laquelle les petits exploitants agricoles tendent à être exclus dans les économies caractérisées par le [ ] ©AFD / L’agriculture contractuelle dans les pays en développement - une revue de littérature 6 /Avril 2013 Synthèse dualisme agraire, mais qu’ils le sont moins lorsque la répartition des terres présente de faibles inégalités. (2) Les constats présentés ici – tirés de 35 « réussites » et de neuf « échecs » – sembleraient conforter l’idée que les agriculteurs contractualisés ont des revenus sensiblement plus élevés que les autres (car c’était un critère de « réussite » essentiel). Une certaine prudence s’impose néanmoins car si de récents travaux économétriques ont traité le biais de sélection au niveau des ménages (et neutralisé ainsi l’effet des caractéristiques observées des participants et des non-participants), la littérature n’a aucunement abordé la neutralisation du biais de sélection des initiatives à évaluer. En d’autres termes, il n’est guère surprenant que de nombreux dispositifs d’agriculture contractuelle offrent aux producteurs des revenus supérieurs aux autres (toutes choses égales par ailleurs), car s’ils n’avaient pas augmenté les revenus, ils auraient sans doute disparu. (3) Les denrées dont la qualité peut fortement varier, qui sont hautement périssables, difficiles à cultiver ou dont le prix au kg est plus élevé, sont plus susceptibles d’être cultivées dans le cadre de contrats ; cependant, des données montrent également que la contractualisation de la culture de produits de base standard peut aussi donner de bons résultats. (4) Cette revue conforte dans une certaine mesure la quatrième hypothèse, à savoir que ce sont généralement de grandes entreprises qui concluent des contrats agricoles. (5) Elle trouve également des éléments étayant la cinquième hypothèse : les dispositifs d’agriculture contractuelle approvisionnent plus volontiers les marchés des pays développés et les supermarchés des centres urbains des économies émergentes et en développement. Il faut remarquer que la comparaison des « réussites » et des « échecs » indique que l’agriculture contractuelle peut être fructueuse dans des conditions socioéconomiques extrêmement diverses, y compris dans les pays en proie à des conflits, dans des États fragiles et dans les pays les moins avancés (car elle permet de surmonter les coûts de transaction élevés sur les marchés peu actifs et imparfaits qui caractérisent fréquemment ces contextes). À partir de 24 des expériences « réussies », nous nous proposons ensuite de compléter la typologie des modèles d’agriculture contractuelle ressortant de la littérature. Les conclusions provisoires sont les suivantes : Avril 2013 / L’agriculture contractuelle dans les pays en développement - une revue de littérature /©AFD [ 7 ] • Le modèle centralisé est utilisé pour les cultures de base traditionnelles, mais aussi pour les denrées de qualité très variable, qui sont hautement périssables, dont la production est techniquement difficile et dont le prix au kg est élevé. Ces dispositifs tendent à fournir l’ensemble des intrants et à desservir à la fois les marchés urbains nationaux (surtout en bétail et en volaille) et les marchés d’exportation. Ce modèle peut être appliqué de manière satisfaisante dans des contextes nationaux très divers, y compris dans les pays en proie à des conflits et dans les États fragiles. Il ne requiert pas de cadres d’exécution, réglementaires et juridiques particulièrement performants pour produire de bons résultats. • Le modèle de la plantation industrielle tend à privilégier les cultures dont la qualité peut fortement varier, hautement périssables, dont la production est techniquement difficile et dont le prix au kg est élevé. Souvent privilégié pour les programmes de réimplantation de populations ou de migrations internes, il ne semble pas adapté à la certification « commerce équitable » ou « agriculture biologique ». Il peut s’avérer intéressant dans des contextes nationaux très divers, y compris dans les pays en proie à des conflits et dans les États fragiles. • Le modèle tripartite est un partenariat public-privé qui tend à se concentrer sur les cultures d’importance nationale. Tous les dispositifs de ce type semblent porter sur des produits de qualité moins variable, moins périssables et moins chers que les deux précédents modèles. Il n’est pas certain que ce modèle soit adapté aux pays en proie à des conflits ou aux États fragiles. • Le modèle informel semble davantage se prêter à la culture de fruits et légumes qui requièrent une transformation minimale ou qui sont transformés sur l’exploitation, sont de qualité assez homogène et font appel à des techniques de production standard. Ces contrats semblent fournir une gamme d’intrants assez réduite ; la taille de l’exploitation étant généralement plus modeste que dans les modèles précédents. Ce modèle compte en partie sur d’autres intervenants (comme l’État ou les organisations non gouvernementales (ONG)) pour la fourniture d’appuis comme la vulgarisation et le crédit. Il n’est pas certain qu’il soit adapté aux pays en conflit et aux États fragiles. • Le modèle intermédiaire semble particulièrement convenir à la culture de produits de base et peut fonctionner dans des contextes nationaux très divers, y compris les pays en conflit et les États fragiles. Il est particulièrement adapté aux contextes où il est difficile de faire respecter les contrats. Les petites entreprises peuvent y recourir en externalisant les échanges avec les agriculteurs. Une faible quantité Synthèse [ ] ©AFD / L’agriculture contractuelle dans les pays en développement - une revue de littérature 8 /Avril
PRODUIRE AUTREMENT A PARTIR DE L'AGROECOLOGIE MAAF DGER
Réalités et perspectives pour les référentiels, les pratiques pédagogiques et les exploitations de l’enseignement agricole
Agroecology day 2
Journée Agro-écologique
Conservation Agriculture Extension Among Smallholder Farmers in Madagascar, Strategies, Lessons Learned and Constraints